Si les sessions concernaient différents domaines de la pathologie mammaire, une place prépondérante a été réservée à l’oncologie médicale, la biologie et la recherche. Avec environ 150 communications et plus de 800 posters présentés, de nombreux sujets ont été abordés. Lors de la première journée, des sessions de synthèse étaient notamment dédiées à la radiothérapie (indications et techniques d’irradiation), à la caractérisation des « lésions prolifératives à haut risque » (assimilables pour certaines à de véritables « lésions précancéreuses »), aux tumeurs surexprimant l’oncogène HER2+ (diagnostic immunohistochimique, durée optimale du trastuzumab, …) ou à la prise en charge des rechutes locorégionales.
Retour sur les temps forts du congrès, notamment le rôle essentiel du traitement initial, l’intérêt du curage axillaire, les bénéfices des schémas de chimiothérapie adjuvante, et l’utilisation des biphosphonates en prévention des rechutes.
L’impact déterminant du traitement initial
Parmi les grandes présentations orales, la William Mc Guire memorial lecture (en souvenir du médecin oncologue texan qui fonda le congrès en 1977) présentée par Sir Richard Peto, illustre épidémiologiste d’Oxford, a fait une synthèse de 30 ans de travaux de son célèbre groupe l’EBCTCG (Early Breast Cancer Trialist Collaborative Group). Les méta-analyses de ce groupe ont permis de montrer, sur des milliers de patientes et avec des reculs de plus de 20 ans désormais, l’intérêt de la radiothérapie après chirurgie conservatrice (tant pour les cancers infiltrants qu’in situ), de même que l’importance de l’hormonothérapie (tamoxifène puis anti-aromatases) et de la chimiothérapie (CMF, puis anthracyclines et taxanes), tant pour la réduction des récidives que l’augmentation de la survie. Pour avoir des données fiables, il est indispensable de disposer de très larges bases de données avec des reculs de 10 à 15 ans au minimum. Cela montre également que l’impact du traitement initial s’observe encore de très nombreuses années après (effet « carry-over » ou « de report »).
Curage axillaire en cas de ganglion sentinelle micrométastasé ?
Viviana Galimberti, de l’Institut européen d’oncologie de Milan, a rapporté les résultats à 10 ans de l’essai IBCSG 23-01, comparant la réalisation d’un curage complémentaire versus une simple surveillance. 934 patientes T1T2N0 avec micrométastases dans le ganglion sentinelle (GAS), ont été randomisées de 2001 à 2010 (845 chirurgies conservatrices et 86 mastectomies). Les taux de survie sans récidive sont superposables à 10 ans : 75 % avec un curage versus 77% dans le bras surveillance (p = 0,24). De même, les taux de survie globale sont respectivement de 88 % versus 91% (p = 0,20). Les taux de récidives axillaires ont été de 0,4 % dans le bras curage et de 1,7% dans le bras observation.
Ces conclusions sont en accord avec celles de l’essai américain ACOSOG Z0011 et confirment que quand le GAS est envahi de façon minime (micrométastase ≤ 2 mm) il n’y a pas d’indication au curage axillaire. Cela est vrai après chirurgie conservatrice avec radiothérapie mammaire complémentaire mais ne peut être encore confirmé pour les mastectomies au vu du très faible nombre de patientes incluses (9%).
Bénéfice des schémas dose dense et séquentiels en chimiothérapie adjuvante
Le Dr Richard Gray, de l’équipe de l’EBCTCG d’Oxford a présenté une méta-analyse sur l’impact des différentes modalités d’administration de la chimiothérapie (CT) adjuvante. Tout d’abord, parmi 10 000 patientes incluses dans 7 essais de CT « dose dense » (administration des cures toutes les 2 semaines au lieu des 3 classiques), il a montré que les schémas « concentrés » réduisaient les taux de rechute à 10 ans de 28,3% à 24% (p = 0,0004) et que la mortalité était également diminuée de 19,6% à 16,8% (p = 0,004).
De même, parmi 6 532 patientes traitées par un schéma séquentiel versus un schéma concomitant, il a montré une réduction des taux de rechutes de 34,9% à 30,4% (p = 0,0001) et une diminution de la mortalité spécifique de 26% à 22,1 % (p = 0,001). Globalement, l’utilisation des schémas « dose dense » ou séquentiels (anthracyclines puis taxanes) conduit à une réduction d’environ 15% des rechutes et de la mortalité spécifique. Le bénéfice est comparable pour les patientes RH+ et RH-, ainsi que pour les autres caractéristiques tumorales. Les limitations de cette étude sont le peu de données concernant l’augmentation des effets secondaires (surtout hématologiques) dans les bras intensifiés ou séquentiels, de même que l’hétérogénéité des protocoles utilisés (doses, molécules et nombre de cycles), de sorte qu’il est difficile d’individualiser le meilleur protocole à proposer, en particulier pour les patientes à haut risque de rechute.
Ajouter un biphosphonate chez les patientes à haut risque de rechute ?
Le Dr Wolfgang Janni de Ulm a présenté les résultats de l’essai SUCCESS, qui évaluait l’intérêt de l’adjonction d’un biphosphonate chez les patientes à haut risque de rechute. 3754 patientes ont été randomisées pour recevoir respectivement 2 ou 5 ans d’acide zolédronique après leur traitement locorégional et adjuvant classique. L’étude n’a montré aucune différence en survie sans récidive ni survie globale, mais par contre une aggravation des effets secondaires dans le bras « bisphosphonates 5 ans » avec en particulier 7,6% d’effets secondaires de grade 3-4 contre 5,1% dans le bras « biphosphonates 2 ans » (p = 0,006).
Enfin, l’hormonothérapie a également été l’objet de présentations majeures. Affaire à suivre dans le prochain « Debrief Cancero » du mois de février…
Oncologue-Radiothérapeute à la clinique Courlancy de Reims et président de la Société française de sénologie et pathologie mammaire (SFSPM)

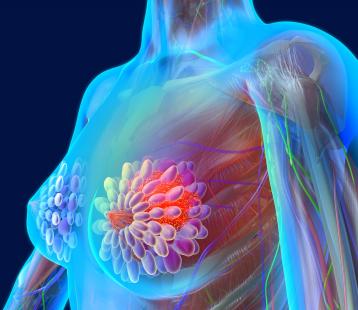
CCAM technique : des trous dans la raquette des revalorisations
Dr Patrick Gasser (Avenir Spé) : « Mon but n’est pas de m’opposer à mes collègues médecins généralistes »
Congrès de la SNFMI 2024 : la médecine interne à la loupe
La nouvelle convention médicale publiée au Journal officiel, le G à 30 euros le 22 décembre 2024